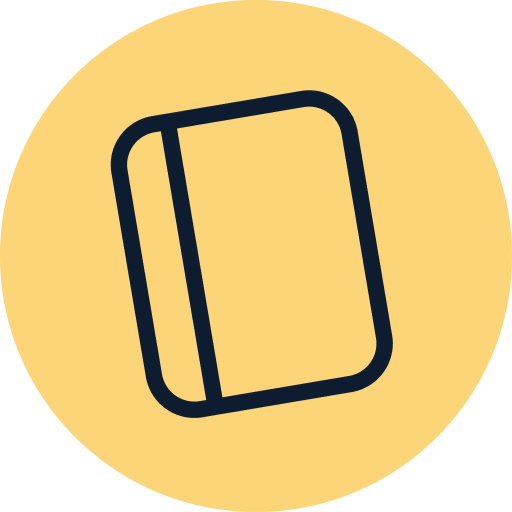Loi Robien : Tout comprendre sur ce dispositif
La loi de Robien de 2009 visait à encourager les particuliers à investir dans l'immobilier locatif en offrant des avantages fiscaux significatifs. En achetant un logement neuf ou en état futur d'achèvement, les investisseurs pouvaient bénéficier d'un amortissement allant jusqu'à 65% du coût du logement, déductible de leurs revenus fonciers. Ce dispositif visait à stimuler la construction et à répondre aux besoins de logements locatifs, particulièrement dans les villes de taille moyenne.Pour profiter des avantages fiscaux, les investisseurs devaient respecter certaines conditions : verser au moins 2 000 euros d'impôts sur le revenu par an, s'engager à louer le logement nu et à titre de résidence principale pendant au moins 9 ans, et ne pas dépasser les plafonds de loyers fixés annuellement. La loi de Robien offrait deux régimes, classique et recentré, chacun avec des modalités spécifiques d'amortissement. En 2009, la loi de Robien a été remplacée par la loi Scellier, qui poursuivait des objectifs similaires de défiscalisation immobilière.