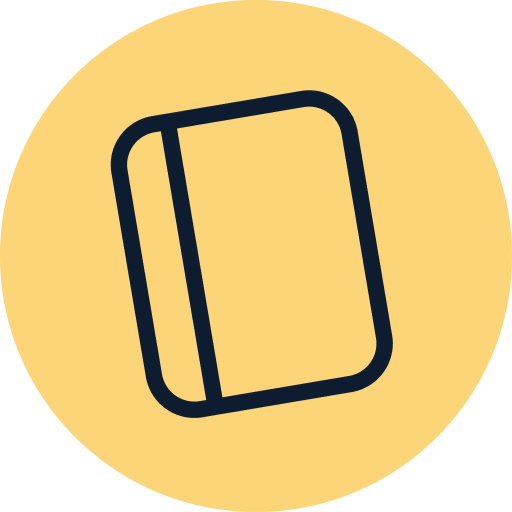Aller au contenu principal - L'impôt sur le revenu est progressif et basé sur des tranches, mais le quotient familial peut réduire son impact.
- Les déductions du revenu global incluent des charges comme les cotisations de retraite et les pensions alimentaires.
- Les déficits professionnels et fonciers peuvent être imputés sur le revenu global pour réduire l'impôt.
- Les réductions et crédits d'impôt incluent des dispositifs tels que la loi Pinel, la loi Malraux, et les investissements dans les PME.
- Investir dans des FCPI et FIP permet de bénéficier d'une réduction d'impôt, sous certaines conditions de conservation des parts.
- Faire appel à des aides à domicile ou investir dans un PER sont des stratégies pour réduire l'impôt tout en préparant l'avenir.