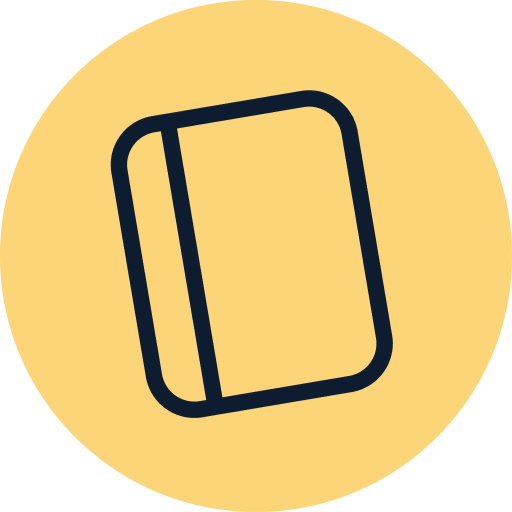Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) jouent un rôle primordial dans l'accompagnement des entrepreneurs, de l'idéation à la concrétisation de leur projet d'entreprise. Nathalie Carré, experte en entrepreneuriat au sein de la CCI, met en lumière l'approche personnalisée adoptée par ces institutions pour soutenir les créateurs d'entreprise. Selon elle, les services proposés visent à doter les entrepreneurs des compétences nécessaires pour réussir, tout en les rendant autonomes dans la gestion de leur entreprise. L'accent est mis sur la nécessité de développer un projet entrepreneurial viable, accepté par le marché et financièrement durable. Les CCI s'adressent à un large spectre d'entrepreneurs, des aspirants aux entrepreneurs naissants, en proposant un accompagnement sur mesure qui répond à leurs besoins spécifiques.
L'accompagnement de la CCI se distingue par sa capacité à adapter ses services à la diversité des profils entrepreneuriaux, qu'ils soient porteurs de petits projets ou ambitieux avec des visions de croissance internationale. Carré souligne l'importance d'un accompagnement complet qui couvre la préparation, le démarrage et la croissance de l'entreprise, insistant sur la valeur ajoutée de l'expérience et des compétences acquises grâce à l'accompagnement de la CCI. Malgré la variété des défis auxquels les entrepreneurs peuvent faire face, y compris en période de difficultés, la CCI se positionne comme un pilier de soutien, offrant des solutions financièrement accessibles grâce à des mécanismes de financement variés. Les résultats parlent d'eux-mêmes, avec un taux de satisfaction de 95% chez les entrepreneurs accompagnés, démontrant l'efficacité de l'approche de la CCI dans la réussite entrepreneuriale.